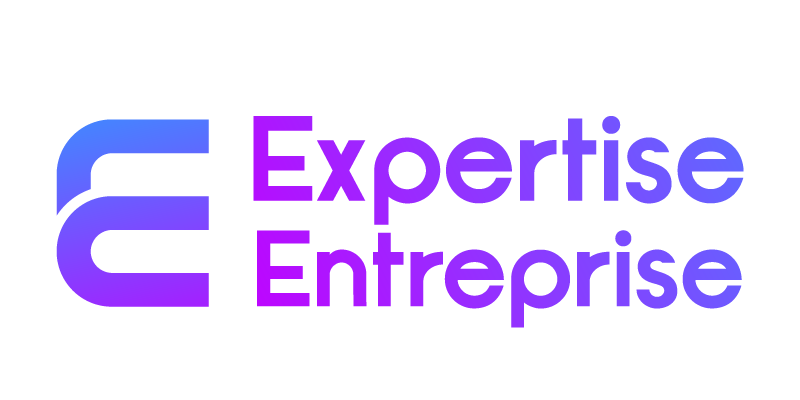Rien n’apparaît sur une fiche de paie sous la mention « salaire du bénévole ». La loi française se montre catégorique : aucun versement n’est autorisé pour le bénévolat, même si des remboursements de frais sont envisageables dans des cas très précis. Quant au volontaire, il peut toucher une indemnité, mais ce statut s’arrête là. Pas de droits comparables à ceux d’un salarié classique.
Tout l’écosystème repose sur des plafonds, des règles strictes et des statuts bien délimités. La frontière entre bénévolat et volontariat rémunéré n’est pas toujours limpide, surtout quand la fiscalité et la protection sociale varient selon le type de mission et la structure d’accueil.
bénévolat et volontariat : quelles différences en matière de rémunération ?
S’engager comme bénévole, c’est choisir d’agir sans la moindre attente financière. On parle ici d’un contrat moral avec l’association : pas de subordination, pas de fiche de paie, pas de congés ni d’indemnités chômage ou retraite. Il arrive tout de même que les frais avancés soient remboursés, à condition qu’ils soient justifiés. Impossible toutefois de parler de rémunération, le bénévolat exclut formellement cette notion.
Le volontariat, lui, relève d’un tout autre registre. Le volontaire signe un contrat qui encadre sa mission, service civique, volontariat international, ou engagement associatif. Ce cadre prévoit une indemnité, généralement forfaitaire, qui ne transforme pas le volontaire en salarié pour autant. Cette somme varie selon la mission : un service civique ouvre par exemple, en 2024, à une indemnité mensuelle proche de 620 euros.
Voici ce qui distingue concrètement bénévolat et volontariat :
- Bénévolat : engagement libre, aucune rémunération, aucun lien hiérarchique.
- Volontariat : cadre contractuel, indemnité mensuelle, mais toujours sans contrat de travail.
Le statut volontaire salarié ne concerne ni les bénévoles, ni la plupart des volontaires. Rares sont ceux qui décrochent un contrat de travail classique, cela reste réservé aux salariés d’associations. Les missions bénévoles et le volontariat rémunéré couvrent ainsi toute une gamme d’engagements, oscillant entre pur don de temps et indemnisation mesurée.
les droits des bénévoles et volontaires face au défraiement
Le sujet du remboursement des frais pour les bénévoles suscite bien des questions au sein des associations. Le plan comptable associatif fixe des règles strictes : seul le remboursement des dépenses réelles, justifiées et sur présentation de pièces, est permis. Le certificat de remboursement devient alors indispensable pour toute régularisation. Gare à ne pas verser de forfait sans justificatif précis : ce glissement ferait basculer la relation dans le champ du contrat de travail, ce qui aurait des conséquences fiscales et sociales immédiates.
Certains bénévoles, soucieux de soutenir davantage leur association, préfèrent renoncer à ce remboursement et effectuer un don de frais. Ce choix permet, sous certaines conditions, d’ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu, à condition que l’association soit reconnue d’intérêt général. La démarche impose de conserver tous les justificatifs et d’obtenir une attestation de la structure. Le montant du don peut alors être déclaré, donnant accès à un abattement de 66 % ou 75 % selon la nature de l’organisme.
Pour les volontaires, la question de la protection sociale se pose aussi. Le service civique ou le volontariat associatif garantissent une couverture minimale : affiliation à la sécurité sociale, parfois complétée par une mutuelle souscrite par l’organisme d’accueil. Les indemnités versées restent modestes, échappent à l’impôt, mais n’ouvrent ni droits au chômage, ni à la retraite. Ici, la ligne entre engagement solidaire et statut social apparaît clairement, sans ambiguïté.
bénévolat, volontariat : montants, conditions et légalité
Le statut de volontaire rime avec indemnité mensuelle, bien différente d’un salaire. Pour une mission en service civique, l’indemnisation tourne autour de 620 euros net. Ce montant, fixé par décret, manifeste une forme de reconnaissance mais ne crée aucun lien de subordination, contrairement au contrat de travail. Cette indemnité échappe aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu. Aucune confusion possible avec le RSA ou les allocations chômage : les volontaires n’ouvrent pas ces droits.
Les modalités varient en fonction du dispositif. Le volontariat international en entreprise (VIE) ou en administration (VIA) dépend du pays d’affectation et du coût de la vie local : les indemnités dépassent souvent 1 400 euros par mois, parfois beaucoup plus selon la destination. Le volontariat de solidarité internationale (VSI) propose des montants qui vont de 100 à 813 euros mensuels, selon l’organisme d’envoi. Quant au corps européen de solidarité, il applique ses propres grilles, généralement plus élevées que le service civique en France.
Le respect des règles s’impose à tous : une indemnité trop élevée, et l’association risque la requalification en contrat de travail. L’Urssaf veille à l’application des textes du code du travail et du code général des impôts. Dépasser ces limites expose à des sanctions lourdes, autant pour l’association que pour le volontaire.
questions fréquentes sur le salaire des bénévoles et volontaires en France
Un bénévole peut-il toucher un salaire ?
C’est impossible. Le bénévolat exclut toute forme de rémunération. Le bénévole met son temps à disposition d’une association sans aucune compensation financière. Toute somme versée doit servir à couvrir des frais réels, justifiés et plafonnés. Aller au-delà revient à instaurer un contrat de travail et les conséquences fiscales et sociales s’appliquent alors.
Qu’en est-il du volontaire ?
Le volontariat s’inscrit dans un registre à part : c’est un engagement sous contrat, avec une indemnité forfaitaire prévue par la loi, qui varie selon le dispositif (service civique, VSI, VIE…). Le statut volontaire salarié n’existe pas : on ne devient ni salarié ni bénévole traditionnel, mais un tiers au statut spécifique.
Voici quelques avantages associés au volontariat :
- Protection sociale : le volontaire dispose d’une couverture sociale sur mesure, souvent financée par l’organisme d’accueil ou par l’État.
- Avantages : certains dispositifs permettent d’accéder à des aides (réductions de transport, accompagnement à la formation), sans lien de subordination.
Passer du bénévolat au volontariat, c’est donc changer de statut et de droits associés. Attention à ne rien laisser au hasard : tout versement qui sortirait du cadre légal peut déclencher une requalification en contrat de travail, et l’Urssaf reste attentive à ces pratiques.
Au bout du compte, si l’engagement bénévole reste une affaire de conviction, le volontariat encadre différemment l’altruisme. À chacun de mesurer où il place la frontière entre don de soi et reconnaissance institutionnelle.